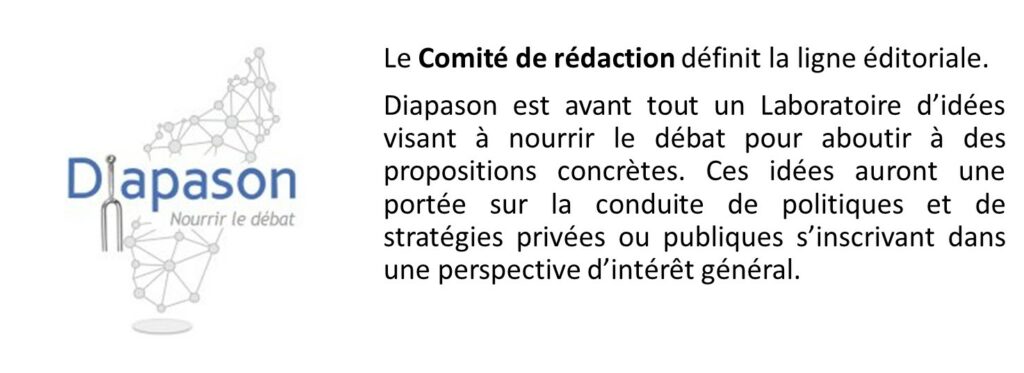À un an de la célébration du 65ème anniversaire du retour à l’Indépendance, Madagascar est jusqu’à présent loin de pouvoir être qualifié de pays démocratique, malgré l’orientation du pays spécifiée dans tous les textes constitutionnels qui se sont succédé depuis 1959. En dépit de ces engagements validés par les citoyens à travers des referenda, l’existence de la démocratie dans le pays est d’abord contredite par les faits. En 64 ans d’indépendance républicaine, Madagascar a connu quatre crises politiques violentes majeures (1972, 1991, 2002 et 2009), évènements auxquels s’ajoutent un assassinat de chef d’État en exercice (1975), un empêchement de Président de la République (1996), et une mini-crise qui a forcé la Haute cour constitutionnelle à prononcer une élection présidentielle anticipée de quelques mois en 2018. La vie politique à Madagascar est donc caractérisée par une instabilité politique qui ne reflète pas « une démocratie qui fonctionne » (Quermonne, 2003). La seule alternance démocratique que le pays ait connu depuis 1960 fut celle de 2014 (illustration 1). Ces défaillances dans le processus de démocratisation sont confirmées par les indicateurs produits par des institutions telles que Freedom House ou le projet Varieties of Democracies (V-Dem, Université de Gottenburg, Suède). Par les faits et par les chiffres, Madagascar mérite donc le qualificatif de démocratie de façade (Pov & Andrianirina, 2021).
Des indicateurs sans équivoque depuis 1960 à ce jour.
Sur une échelle allant de 0 (bas) à 1 (haut), l’Indicateur de démocratie libérale proposé par le projet V-Dem reflète dans quelle mesure l’idéal de démocratie libérale est atteint. Le comportement de cet indicateur montre que sur les 64 années couvrant 1960 à 2023, la moyenne de l’indicateur de démocratie libérale pour Madagascar selon le projet V-Dem est de 0,173. Ce chiffre illustre l’énorme écart avec la valeur idéale de 1.
Une autre source faisant autorité dans le domaine de la démocratie est le classement établi depuis l’année 1972 par Freedom House, qui classifie les pays en « Libres », « Partiellement libres » et « Pas libres ». Ses données indiquent que Madagascar n’a jamais été classée parmi les pays libres. Le pays a été la plupart du temps au rang des pays partiellement libres, avec même un statut non libre pendant cinq années (1976, puis de 1978 à 1981). Par conséquent, en plus des faits cités précédemment, ces chiffres renforcent l’affirmation d’une absence de démocratie pleine à Madagascar.
Illustration 1. Les alternances à Madagascar de 1960 à 2019. Source : Rabemananoro (2021).

Enfin, le pays est classé sans discontinuer comme un régime hybride par l’Economist intelligence unit (EIU) depuis 2006. Également qualifié par Larry Diamond de « pseudo-démocratie », un régime hybride allie les composantes des régimes autocratiques et démocratiques, mais l’existence formelle d’institutions politiques démocratiques, comme les compétitions électorales multipartites, masquent la réalité de domination autoritaire (Diamond, 2002).
De tout ce qui précède, il apparaît par les faits et par les chiffres, que Madagascar n’a jamais été une démocratie depuis 1960 jusqu’à ce jour.
Rappelons que Dufy et Thiriot (2013) évoquent « Quelques 550 types et sous-types de démocraties ou autoritarisme ». Nous n’entrerons pas dans les débats sur ces multiples formes et définitions de démocratie, et considérons que la forme de démocratie que l’on tente d’appliquer à Madagascar est la démocratie libérale, système politique qui se caractérise par des élections libres et équitables, ainsi que par des institutions indépendantes qui protègent les droits des citoyens dans le cadre d’une séparation des pouvoirs efficace (Diamond, 1999 ; Zakaria 2003).
Thèses culturelles et théories développementalistes.
Ce constat des faits renforcé par les chiffres nous invite à nous poser la question suivante : malgré le fait que l’engagement envers la démocratie ait été constitutionnellement établi depuis plus de six décennies, pourquoi Madagascar peine-t-elle à réduire le grand écart entre les valeurs démocratiques professées et la façon de les appliquer concrètement ?
A priori, ce constat semble cautionner les thèses culturelles qui soutiennent que la démocratie ne peut s’établir que dans les États occidentaux, qui ont les bases culturelles et institutionnelles nécessaires (Habermas 1991, Huntinton 1991, Lipset 1959). L’ancien président malgache Didier Ratsiraka a également soutenu que la démocratie doit être « amodiée » et non copiée aveuglément de l’Occident vers l’Afrique[1], et il a été rejoint dans ce sens par le Pasteur Richard Andriamanjato :
« Notre conception de la démocratie ne cadre pas avec notre culture… La démocratie moderne est une démocratie savante. Elle implique de faire progresser culturellement le pays avec ses 50% d’analphabètes qui ne sont pas à même d’accéder à l’information et de l’utiliser… Comment des analphabètes peuvent-ils discuter d’un programme de gouvernement ? Les députés d’aujourd’hui ne parlent pas d’un problème national, ils parlent de problèmes de maires et de questions locales car c’est ce que les gens sont à même de comprendre » (Madanight.com, 2008).
Ces thèses culturelles ont toutefois été combattues par de nombreux auteurs, à commencer par le prix Nobel d’économie Amartya Sen (2006). Luc Sindjoun (2005) souligne que « l’argument de l’importation ne suffit pas à invalider la culture démocratique », en rappelant que les pays africains se sont réapproprié des cultures venues d’ailleurs, comme des religions ou des langues.
Toutefois, au-delà de ces débats intellectuels, l’Histoire elle-même a offert de nombreux contre-exemples concrets à ces thèses culturelles. Les rapports de Freedom House classent régulièrement comme « libres » de nombreux pays en dehors du monde occidental.
Cela nous amène donc à accorder crédit envers une seconde catégorie de théories appelées développementalistes (Lipset 1959, Dahl 1971, Przeworski & Limongi 1997, Inglehart & Welzel 2005). Elles soutiennent que les dysfonctionnements démocratiques s’expliquent par un niveau de développement économique et politique qui n’aurait pas encore atteint un stade suffisamment avancé. Outre ce niveau de développement économique nécessaire, Richard Rose and Doh Chull Shin (2001) considèrent que les difficultés de démocratisation des pays de la troisième vague de démocratisation est un mauvais séquençage, ce qu’ils ont appelé « démocratie à rebours » (democratization backwards). Ces pays n’ont pas commencé par bâtir les institutions inhérentes aux États modernes (telles que l’État de droit, les institutions de la société civile et la redevabilité du dirigeant) avant d’avoir mis en place des élections compétitives. Cela se traduit par des lacunes dans le domaine des institutions et du système électoral.
Depuis la présidentielle de mars 1989 jusqu’aux scrutins les plus récents dans le pays, les polémiques récurrentes après chaque édition reflètent le manque de fiabilité du système politique sur une de ses caractéristiques essentielles qu’est le suffrage universel. Conséquence au fil des ans : le taux de participation aux élections présidentielles ne cesse de décroître, et depuis les deux dernières éditions de 2018 et 2023, battent des records d’abstention au-dessus de 50% (illustration 2).
Illustration 2. Évolution des taux de participation aux premiers tours (1T) et second tour (2T) des élections présidentielles (1965 – 2023)
(D’après Rabemananoro (2021), mise à jour par nos soins pour inclure 2023)

Pistes d’explication.
À ce stade, nous pouvons articuler notre tentative d’explications des difficultés de démocratisation à Madagascar autour de quatre points principaux.
Culture politique. Pendant des siècles, les Malgaches sont successivement passés par diverses périodes qui ont une caractéristique transversale, à savoir le caractère non-démocratique du régime : période monarchique jusqu’en 1896, période coloniale jusqu’en 1960, période néocoloniale et autocratique sous la première république jusqu’en 1972, puis période socialiste autocratique sous la deuxième république (1975-1991). Les citoyens ont enfin pu bénéficier d’un peu plus d’ouverture dans les libertés civiles et les droits politiques grâce à la période libérale, entamée avec l’avènement de la IIIème république en 1992. La culture politique est donc marquée par ce passé historique peu favorable à la démocratie sans les ajustements nécessaires. Comme le souligne Ferrero (1945), on peut questionner la capacité à voter de manière pertinente d’une masse de « millions d’hommes et de femmes habitués à obéir » et à laquelle serait soudain offerte l’opportunité de gouverner en « peuple souverain ».
Inégalités. La société malgache est inégalitaire du fait de la persistance de clivages sociaux basés, d’une part, sur l’existence d’ethnies et de castes qui orientent encore certains comportements dans de nombreuses régions du pays, et d’autre part, sur la prévalence de la pauvreté et les différences de développement entre les différentes régions. L’importance de ces clivages sociaux ne permet pas à Madagascar d’établir une démocratie réelle (Rabemananoro 2021), parce que dans ce contexte, l’égalité entre citoyens qui est à la base de la démocratie n’est pas une réalité, ni dans les têtes, ni dans les faits. Le régime qui existe à Madagascar favorise donc uniquement les couches sociales qui ont la puissance nécessaire pour créer un environnement favorable à leurs ambitions politiques ou leurs activités économiques. Toutefois, les deux aspects se rencontrent souvent, ce qui fonde des alliances entre politiciens et opérateurs économiques se soutenant mutuellement, et s’arrangeant pour écarter ceux qu’ils ne reconnaissant pas comme faisant partie du « clan ». Ces situations de monopole créent des frustrations et des inégalités qui sont crisogènes.
Dérives vers la ploutocratie. L’accroissement des inégalités abordé précédemment risque d’éloigner de plus en plus Madagascar du chemin de la démocratie pour dériver vers la ploutocratie, le gouvernement par l’argent. Or, de tous temps et en tous lieux, il a été prouvé qu’être riche ne rime pas nécessairement avec talent, intégrité, patriotisme ou démocratie. Depuis la présidentielle de 2001, l’importance des ressources financières est devenue le facteur déterminant des élections à tous les niveaux : présidentielles, législatives, municipales, ou sénatoriales. Elles sont nécessaires pour les opérations de charme (goodies, cuvettes, t-shirts, concerts, affiches, publicités etc.) et la logistique inhérente à toute campagne électorale, sans oublier les opérations qui se déroulent « sous la table » auprès d’acteurs influents du système électoral. Ce système ploutocratique va maintenir en place un système de corruption. En outre, ces ressources financières conséquentes nécessitent des sponsors, qui, comme tous les investisseurs, vont rechercher un retour sur investissement. Outre les conditions opaques de ces sponsoring, il y a une question fondamentale : qu’est-ce qui leur est promis en contrepartie de leur soutien financier ?
Inadéquation du contexte socio-économique. Plus que d’une inadéquation culturelle pour expliquer les dysfonctionnements de la démocratisation, nous parlerons plutôt d’une inadéquation socio-économique : le contexte dans ces domaines ne permet pas à la démocratie de se développer de manière pérenne. En effet, pour s’établir de façon solide, celle-ci nécessite un contexte favorable et des moyens importants. Ces ressources favorisent l’éducation et l’instruction de la population, ce qui favorise ensuite la participation politique de citoyens informés et valorisant le sens critique. Cette participation à l’espace public est également consolidée si l’accès aux médias est facilité par les investissements nécessaires pour couvrir la plus large portion possible de la population. De son côté, l’État doit également mobiliser des moyens afin de renforcer les institutions, grâce à la formation des fonctionnaires ainsi que la mise en place d’équipements et de systèmes qui permettent un environnement propice à la démocratie. Exemple concret : les infrastructures routières et technologiques permettent l’acheminement rapide et transparent des résultats des élections, ce qui va réduire la suspicion de fraudes, et donc renforcer la confiance dans le système électoral.
Ces quatre points alimentent la démocratie de façade, dont les facteurs structurels fondent le moule crisogène de la vie politique à Madagascar : un système politique inefficace à répondre aux exigences qui lui sont soumises ; un système d’acteurs d’équilibre inapte à réguler la tension politique ; des écarts flagrants entre une relative bonne connaissance des principes de la démocratie et leur application concrète, à commencer par le manque de crédibilité du système électoral ; une socialisation politique défaillante ; l’inefficacité des formes de contestation non violentes ; et la présence de clivages qui obère le principe d’égalité pourtant à la base de la démocratie (Rabemananoro, 2021).
Conclusion.
Au-delà de ce qui a été évoqué précédemment, le principal défi qui se pose face à Madagascar dans ses efforts de démocratisation est celui des hybridations. Il y a en effet un équilibre à rechercher sur de nombreux plans : le désir de démocratie dans un contexte de réminiscences de la monarchie ; une volonté de sauvegarde de la malgachéité et des valeurs traditionnelles, malgré une modernisation inexorable à cause de la mondialisation des échanges ; et une volonté de s’affirmer comme une nation souveraine et indépendante au milieu des enjeux géopolitiques. De façon transversale, il y a la nécessaire élévation des dimensions du développement humain (santé, éducation, revenu) et l’amélioration de la situation économique et de la gouvernance. En attendant, toutes ces hybridations créent des processus dynamiques et interdépendants qui requièrent des ajustements quelquefois drastiques, mais qui nécessitent également des moyens financiers et une forte volonté politique. Ces ajustements sont requis si Madagascar veut progresser sur le long et difficile chemin de la démocratisation.
Selon le Centre national de coopération au développement (CNCD), organisation de la société civile en Belgique, « Loin de favoriser la démocratisation, la mondialisation néolibérale a dès lors plutôt tendance à l’affaiblir ». Citant l’auteur Yascha Mounk (2018), le CNCD explique que les effets pervers des politiques économiques néolibérales « favorisent la financiarisation et les inégalités – faisant le lit du national-populisme auquel se rallient les » perdants de la mondialisation » ». Ces risques sont réels pour un pays marqué par la pauvreté comme Madagascar.
Il y a donc une question qu’il faut avoir le courage de se poser au vu d’un bilan démocratique peu reluisant depuis plus de six décennies : la classe politique malgache trouve-t-elle vraiment un intérêt à améliorer la démocratie et ses dimensions telles que l’État de Droit, le niveau d’éducation de la population, ou encore la séparation des pouvoirs ? En effet, il apparaît depuis 1960 à ce jour que ce sont les défaillances dans ces domaines qui favorisent l’accès et le maintien au pouvoir de ceux qui savent profiter des failles.
Dr. Andrianirina, politiste, juin 2024.
[1] Didier Ratsiraka, extrait de son intervention au 35ème Sommet de l’O.U.A. – Alger, 13 juillet 1999
Travaux cités
- Dahl, R. A. (1971). Polyarchy, participation and opposition. Yale University Press.
- Diamond, Larry. (2002). Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy, 13(2), 21-35.
- Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.
- Dufy, C., & Thiriot, C. (2013). Les apories de la transitologie : quelques pistes de recherche à la lumière d’exemples africains et post-soviétiques. Revue internationale de politique comparée 2013/3 (Vol. 20), 19-40.
- Ferrero, G. (1945). Pouvoir, les génies invisibles de la cité. Plon.
- Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press. (Original work published 1962)
- Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge University Press.
- Lipset, S. M. (1959). Political man: The social bases of politics. Doubleday & Company.
- Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy. Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Harvard University Press.
- Pov & Andrianirina (2021). Dictionaire de la démocratie de façade. L’Harmattan.
- Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). Modernization: Theories and facts. World Politics, 49(2), 155-183.
- Quermonne, J.-L. (2003). L’alternance au pouvoir. Montchrestien.
- Rabemananoro, E. (2021). Les crises politiques violentes malgaches de 1972 à 2009 : une démocratie de façade ?. Institut d’Études Politiques Madagascar.
- Rose R. & Shin S. C. (2001). Democratization Backwards: The Problem of Third-Wave Democracies. British Journal of Political Science Vol. 31, No. 2 (Apr., 2001), 331-354.
- Sen, A. (2006). La démocratie des autres. Payot et Rivages.
- Sindjoun, L. (2005). La culture démocratique en Afrique subsaharienne : comment rencontrer l’arlésienne de la légende africaniste. Consulté le mai 28, 2019, sur docplayer.fr: https://docplayer.fr/22445455-La-culture-democratique-en-afrique-subsaharienne-comment-rencontrer-l-arlesienne-de-la-legende-africaniste.html
- Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W.W. Norton & Company.